Cette pratique de la vidéo participe-t-elle de cette économie ?
Oui, pour éviter l’encombrement. Elle s’est d’ailleurs développée lorsque je n’avais plus d’atelier. L’idée de la légèreté d’un travail me plaît. Dans Dreamers semblent s’instaurer des croisements entre des personnages de différentes époques, contrairement à des recherches antérieures centrées sur une seule figure. Dans le but de m’effacer afin de laisser parler les différentes rumeurs, je voulais mettre en place un récit à plusieurs voix. On part du vide et on laisse parler les voix, on improvise. On suit l’expérience d’un personnage qui se diffracte en plusieurs “personas“. Lors de cet été 2013, j’avais cette intention de rendre compte d’une rumeur apocalyptique qui enflait, – ce genre de rumeurs qui s’accroissent durant les temps de crises, du déjà-vu et de l’épuisement des choses. Cela s’est vraiment déclenché au visionnage du film Picnic at Hanging Rock de Peter Weir.
Vous ne connaissiez pas ce film ?
Je connaissais ce film par les discussions que j’ai pu avoir avec des gens qui l’avaient vu. C’était donc un faux souvenir quelque chose qui n’était pas encore accompli.
Que représentait-il pour vous ?
C’est un film indépendant australien, des années 70, qui a focalisé l’imaginaire d’un pays et d’une époque. Lors de cet été 2013, je suis tombée par hasard sur le film programmé à la TV. Cela a été un choc : la phrase énigmatique d’Edgar Allan Poe : … Tout ce que nous vivons ou semblons être n’est qu’un rêve dans un rêve, All that we see or seem Is but a dream within a dream. La lenteur contemplative du rythme alternant entre deux réalités, la flûte de Pan de Gheorghe Zamfir.
Ce film m’a replongé dans le souvenir d’un voyage que j’avais fait en 1999 en Australie, et qui avait marqué un tournant dans ma vie.
Il raconte la disparition d’un groupe de jeunes filles, dans un lieu géologique étrange, Hanging Rock, un ancien lieu de culte aborigène. Peter Weir a adapté un roman de Joan Lindsay qui n’a jamais voulu expliquer ses sour-ces, le mystère demeure… Le reste du film montre les changements engendrés par cette disparition dans l’étouffant collège, microcosme d’une société anglaise coupée de la vie naturelle et régi par d’austères et iniques règles que le choc de l’évènement rendra caduques. En Australie, la nature domine tout et les paysages renvoient de façon fulgurante au passé de l’humanité en s’offrant, sous un jour d’éternelle jouvence. Nous avions décidé d’aller jusqu’à Ayers Rock ou Uluru ; nous ne l’avons jamais atteint. Nous voulions échapper à une tornade, une déviation du courant El Niño. Pendant le voyage et les longues heures dans le 4×4 climatisé, je lisais, pour tromper l’ennui et parfois l’angoisse du vide, Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Je vivais les deux espaces parallèles simultanément, la déchéance du monde occidental face à la candeur de celui des origines. Don Beale, notre compagnon de route, m’apostrophait ironiquement en australien typique : «Vero, why don’t you stop reading this fucking french book?» L’immensité de l’Australie peut être effrayante et anxiogène. Durant ce voyage, j’ai visité des lieux qui tous, m’ont appris quelque chose. Ce déplacement m’a plongé dans ce que peut être le cheminement aborigène, une errance calculée le long des pistes chantées, dialogue intime avec les lieux et l’espace.
Donc ce film est un mélange d’expériences vécues, d’images souvenirs et de fictions ?
Oui, une espèce de synthèse transversale qui traverse tout. La phrase du poème de Poe dans Picnic at Hanging Rock a été le starter qui a réactivé tout cela. Elle m’a donné le titre, car à la fin tout se mélange, les rêves, les souvenirs vécus ou imaginés, les moments, les images, les oeuvres.

Pour reprendre votre emprunt à Poe, c’est l’énigme chez lui, qui part souvent d’une chose évidente parce que présente dans le contexte quotidien, mais qui reste cachée tant que les personnages ne la reconnaissent pas, ne la nomment pas. Qu’arrivez-vous à nommer dans ce flux quotidien ?
Comme le Chevalier Dupin dans Double assassinat à la rue morgue ou La lettre volée, je suis partie du principe qu’il y avait une énigme à résoudre et que les apparences sont trompeuses. La solution était peut-être sous mes yeux, peut-être plus accessible qu’elle en avait l’air. J’ai décidé de composer une espèce de journal de bord de tout ce que je rencontrais, lisais, voyais pendant ce mois d’août où tout semblait à l’arrêt. Qu’ai-je trouvé ? Mes marottes et mes fondamentaux. J’ai pris un malin plaisir à cultiver un process qui a déclenché une sorte de mécanisme. Après un moment de réflexion et de recherches, les éléments visuels sont venus s’intercaler, en écho aux textes et à la musique. Les éléments se sont emboîtés, imbriqués presque à mon insu.
Un hasard objectif ou une méthodologie pour articuler les choses importantes, un peu à la façon des mnémosynes d’Aby Warburg ?
Peut-être les deux. Le hasard objectif s’apparente à une méthode chamanique qui présuppose que par sa volonté, son désir ou en inventant des rituels, on peut entrer en interaction subtile avec le monde, “précipiter le hasard en de pétrifiantes coïncidences“ [André Breton, Nadja, 1928]. Il y a aussi la notion Jungienne de ‹“synchronicité“ une coïncidence qui fonctionne à l’insu de la conscience, comme un signe qui advient, que l’on décrypte ou pas, – un clignotement de l’univers qui révèle une ouverture, comme dans l’histoire du rêve du scarabée d’or. Quant à Warburg, constituer sa collection d’images l’a certainement sauvé de la folie, de la dépression, de la culpabilité. Peut-être a-t il eu ainsi l’impression de sauvegarder un pan du monde ? Il a cherché à “créer des plans d’intelligibilité“, à “vaincre le chaos par un plan sécant qui le traverse“, comme le relève Georges Didi Hubermann*, en citant Deleuze et Guattari : « Sampler le chaos en ramenant des paquets d’images ». L’idée du fragment, du montage, de l’échantillonnage nous ramène vers la constance d’un mythe universel, d’une aspiration humaine. Chacun a sa méthodologie pour constituer son “Aleph mystique“
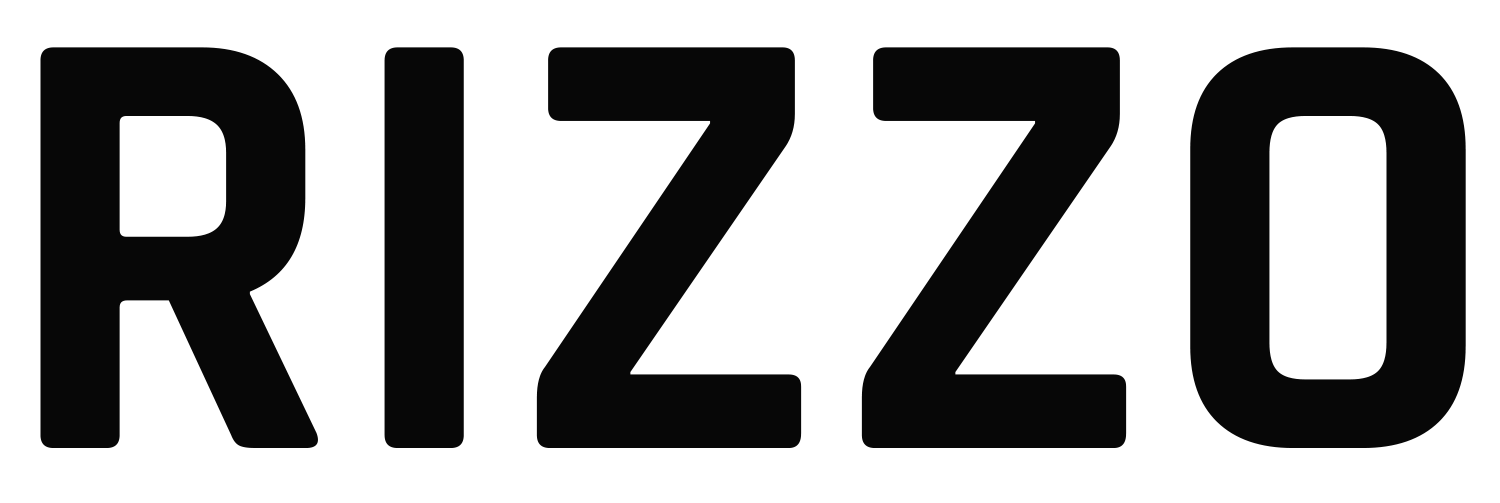

0 Thoughts on Dreamers artist book, extrait de l’entretien avec Lise Guéhenneux – 2