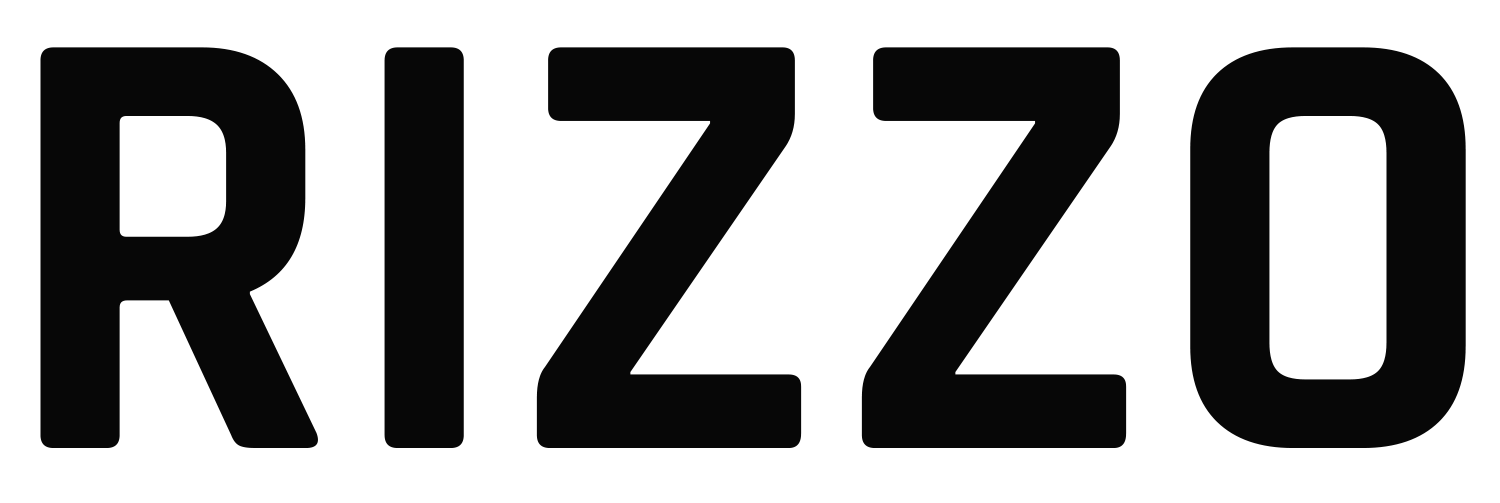Texte de Patrick Lhot (Enseignant histoire de l’art – Université Aix-Marseille1) à l’occasion du Colloque « Vertu des Contraires » et de l’exposition à la Fondation Vasarely le 23 nov. 2012.
Véronique Rizzo appartient à cette famille d’artistes qui font recours au temps, non pas sous la forme d’une nostalgie, d’un mal du retour. Rien de l’ordre de la mélancolie dans son travail, qui, au contraire, semble décliner les formes d’un jeu, d’un plaisir, non sans ironie toutefois…Elle semble utiliser la temporalité comme matériau conceptuel.. La référence explicite, que fait l’artiste à l’utopiste Gusto Gräzer, un des fervents habitués du Monte Verita, au début du XXème siècle, fait briller, non sans contradiction, la présence spectrale d’une aventure de l’esprit dans l’un des plus formidables laboratoires de « re-formation » de la vie.. Se confronter à cette aventure (plus que s’y référer), quand on est artiste, outre la consonance moderniste des composants plastiques mis en jeu dans les oeuvres (peinture, assemblage, projections lumineuses de formes géométriques, en mouvement dans l’espace), c’est, principalement, « faire retour au temps ». dans le sens le plus tactile d’un choc perceptif, comme opérer un mouvement arrière sur le curseur temporel de l’histoire, générant, par contre-coup, tel un caillou jeté à la surface de l’eau, une série de formes qui se propagent et se transforment. Si la notion du « moderne », chez Baudelaire, témoigne d’une expérience « affective » du temps, dialectique entre mélancolie du passé et surprise du nouveau , la plasticité du temps dit « postmoderne » se fait, non pas, dans le hors temps d’ une fin de l’histoire, mais par jeu de contre-coups temporels, de contre-temps tactiles, de micro-histoire(s) rebondissantes et génératrices de formes et de situations. Ce n’est pas la moindre qualité du travail plastique de Véronique Rizzo, que de nous inscrire, nous spectateurs, dans cette dynamique vertueuse des temps contraires.
| (English Translation) Véronique Rizzo belongs to this family of artists who use time, not as a nostalgia, or a sore back. Nothing about melancholy in her work, which, however, appears to be declining forms of a game, of a pleasure, not without irony, however … She seems to be using temporality as conceptual material. The artist refers explicitly to the utopian Gräzer Gusto, one of the regulars of Monte Verita, in the early twentieth century. This reference puts in light, not without contradiction, the spectral presence of a mind adventure in one of the most amazing laboratory of « reformation » of life. Confront this adventure (rather than refer to it), as an artist, besides the modernist sounding of plastic components brought into play in the works (painting, assembly, light projections of geometric shapes, moving in space) is mainly « to return to the time. In the broadest tactile sense of a perceptual shock, as operating a backward movement on the time cursor of history, generating, as a repercussion, like a stone thrown into the water surface, a series of forms spreading and evolving. If the notion of « modern », in Baudelaire’s work, reflects an « emotional » experience of time, distinguishing between melancholy of the past and surprise of the new, the plasticity of the so-called « postmodern » time is happening, not in the off time of the end of a story, but by game of time consequence, of tactile hitches, of micro-stories bouncing and generating forms and situations. This is not the lesser quality of Véronique Rizzo’s plastic work, to place us, we spectators, in this virtuous circle of opposite time. Patrick Lhot translation Matthieu Jorrot |
Véronique Rizzo : de l’art et de l’éros dans la vie – Sylvie Coellier – 2010
Aujourd’hui de nombreux artistes réexaminent la modernité en donnant un autre sens à des formes autrefois réservées au service exclusif de la vision progressiste de l’art. Assez peu d’entre eux revisitent comme le fait Véronique Rizzo, l’abstraction géométrique qui pourtant rassemble des enjeux théoriques toujours vifs. Sous le mot de « grille », Rosalind Krauss a montré dans un article célèbre comment l’abstraction moderniste renvoyait de façon ambiguë tantôt à une totalité de type spirituel, tantôt à une vision rationnelle, matérielle, concrète. Dans la version spirituelle, la référence aux religions ou aux philosophies orientales se faisaient volontiers le véhicule d’une réconciliation entre le corps et l’esprit, jusqu’alors si substantialisés en entités distinctes par la culture occidentale. L’autre versant, affirmant l’autonomie de l’art par dissemblance radicale avec le monde, devenait l’instance représentative du progrès par les sciences et les techniques. Les deux approches gardaient une vision utopique. Au cours des années 1960 l’art minimal, bouleversant le modernisme, mit à jour la volonté hégémonique de la grille totalisante et révéla sa structure utilitariste en phase avec la reproduction industrielle. Ceci amena bientôt la critique postmoderne. Ainsi Peter Halley, qui est une référence pour Véronique Rizzo, inversa la signification de l’abstraction géométrique : ses carrés se mirent à signifier les « cellules » architecturales ou carcérales, ses lignes les réseaux cachés des énergies utilitaires et des circuits informatiques. Pour lui, dit-il en 1990, la « situation totalisée » à laquelle la modernité tendait « existe presque. (…) Mais ce n’est plus de l’utopie, ce n’est plus idéaliste ni abstrait. Mais bien réel et cauchemardesque[i]». Cette critique pessimiste est toutefois temporisée par Véronique Rizzo. Aujourd’hui les technologies numériques représentent sans doute le développement le plus étendu du « progrès » scientifique dans lesquels la modernité avait foi, et que l’art concret — avec Vasarely par exemple, pour qui le noir et le blanc correspondaient au 0/1 de l’ordinateur— fut le premier à célébrer. En reprenant des motifs « vasaréliens », Véronique Rizzo n’en cache pas l’estimation négative. En titre d’une série de dessins, elle évoque ainsi Kafka et écrit : « I don’t want to be a number ». De plus, elle confère à ces dessins un aspect de papier peint à la mode des années 1970, édulcorant l’affirmation progressiste et lui attribuant le statut de décor pour nouveaux consommateurs. De même, lorsque Véronique Rizzo reprend la tension entre l’applat et l’effet de convexité que pratiquait l’artiste hongrois, elle nous renvoie à notre actuelle dépendance visuelle à la planéité de l’écran comme support de la vision spatiale. Pourtant, sa critique ne peut exclure le plaisir, d’ordre sensuel, que procurent le maniement et le spectacle des nouvelles technologies. Il est difficile aujourd’hui de penser que le monde puisse s’en passer, et pour « surmonter notre perpétuel progrès[ii] » comme le dit autrefois Malevitch, il semble préférable de le comprendre et de l’absorber en toute connaissance. C’est la voie qu’a choisie Véronique Rizzo, qui peut ainsi montrer notre propre ambiguïté à l’égard des technologies en question. L’une de ses installations les plus révélatrices à cet égard est Panopticon XXXX[iii]. L’œuvre révèle comment une pression entre la vision totalisante et un fractionnement, entre la séduction et les effets pervers des technologies peut opérer. Le titre se réfère à la conception des prisons de Jeremy Bentham dont Foucault dans Surveiller et punir a montré la violence produite par le regard central et péripatéticien interdisant toute vie privée. Or le même Bentham prônait à l’époque des Lumières une philosophie du bonheur pour tous. L’installation de Rizzo retrace la voie depuis cette idéologie jusqu’à ses répondants actuels qui, sous couvert de progrès social instaurent une surveillance globale. Au plafond d’une cellule, dominant de haut le spectateur, se déploient les éclats kaléidoscopiques d’une vidéo sans cesse changeante, rayonnant d’un centre en spirale, en fleur, en étoile, et tantôt lumineusement jaune, tantôt violet pourpre. Cette accroche dominante dispense sa fragmentation sur le spectateur dominé : le mouvement excentrique des couleurs exerce une fascination troublante, qui masque un moment au regardeur son état de passivité hypnotique. Seul l’inconfort de sa position rappelle le spectateur émerveillé du ballet des technologies à sa condition, lui permettant alors une réflexion contemplative puis un recul critique. Dans d’autres œuvres, les Sphères de réalités possibles (2001) par exemple, le plaisir visuel qui saisit le spectateur des globes transparents aux couleurs raffinées fait envoler l’imaginaire. Mais le travail plus complexe des Balls, qui joue délibérément de la relation aux économiseurs d’écran d’ordinateurs, affine notre saisie des interférences entre plaisir et dommages collatéraux. Leur principe en soi est simple, cependant il s’ouvre sur une infinité de possibles : une sphère virtuelle que l’on associe très vite à une balle de flipper bondit sur la surface écranique et semble rencontrer des obstacles tantôt invisibles, tantôt constitués d’une ligne, ou du bord de l’écran, ou d’une « niche » circulaire dans laquelle elle vient se loger. A chaque obstacle de son parcours, la « balle » produit des inflexions de lignes et de couleurs, par flashes lumineux et colorés, ou bien en éventails chamarrés où chacun reconnaîtra l’interaction entre la décision de l’artiste et la conséquence mathématique (rationnelle…) issue de la conception du logiciel. Composée de courtes séquences, la série des Balls produit des coupures qui nous dessaisissent de la plongée fascinatoire, nous permettant à la fois la jouissance visuelle du mouvement abstrait et la critique de nos comportements devant le spectacle de la technologie. Par ailleurs, le mot Balls renvoie en anglais assez trivialement à une spécificité du corps masculin. Et pour en référer à nouveau à Krauss, nous pouvons nous souvenir de l’érotisme que la théoricienne excipait des rotations des disques de Duchamp et du narcissisme qu’elle imputait à la vidéo. Ne faut-il pas alors comprendre notre fascination visuelle, et cette tension vers le progrès technologique qui la suscite et n’en finit jamais, comme le produit d’une incoercible pulsion libidinale humaine (masculine ?) ? Il faut alors peut-être rappeler la matérialité du corps (féminin ?) pour suspendre l’abstraction du sujet, et peut-être le morcellement qui en découle. Plusieurs installations de Véronique Rizzo peuvent s’interpréter ainsi comme un repositionnement du corps, devenu le pendant nécessaire à la fascination pour la dématérialisation. Dans Bouches[iv] (2002) le spectateur, allongé sur des coussins anthropomorphes comme autant de morceaux de corps, contemple une vidéo très psychédélique dont le motif de départ, exposé au mur, évoque le design organique des années 1970. L’abstraction du dessin, dont le titre, Bouches, donc, révèle l’origine organique et érotique, amène l’imaginaire à une plongée mentale dans son univers suggérant une unité par extase. Sans l’affirmer, cet organe sensuel et le contact du spectateur avec les éléments de tissu anthropomorphes ne sont pas sans évoquer l’art de Lygia Clark. Une autre œuvre, « Free your ass and your mind will follow » (2005) [v], rend à celle-ci un hommage explicite. D’un abord plus abstrait, l’œuvre invite le spectateur à s’asseoir ou s’allonger sur le sol de tapis de mousse recouverts de skaï coloré selon un dessin proche des superficies moduladas que Clark avait créées peu avant le manifeste du néo-concrétisme de 1959. Ce texte, rédigé avec six autres participants, déclarait l’erreur des artistes concrets « rationnels », et défendait un art plus cosmologique, pour « l’œil-corps et non l’œil-machine ». Ce fut un tournant qui amena par la suite Clark à développer son art tactile et thérapeutique contre le morcellement du corps et sa séparation d’avec l’esprit. Dans l’installation de Rizzo, les corps des spectateurs, détendus, accompagnent les regards qui se laissent emporter par les mouvements d’une vidéo ou se concentrent sur des disques aux lignes se resserrant vers un centre bouche ou sexe. L’œil-corps est ainsi amené à un état méditatif de réconciliation unitaire porté par la couleur.
L’une des constantes de l’utopie moderniste fut de rendre tout l’environnement humain artistique, de faire en sorte que la vie soit absorbée dans l’art. Le postmodernisme a depuis critiqué l’envahissement planétaire des architectures rationalistes qui en dérivaient. Mais dans le même mouvement, il a condamné l’utopie, voire l’idée même qu’une amélioration de la vie (un progrès) soit possible. Pour Véronique Rizzo, il est aujourd’hui urgent de raviver, à échelle nettement moins autoritaire que ne le voulut le modernisme, le réinvestissement de l’art dans la vie. C’est tout le projet de son travail récent sur les tentes. Ce sont des habitats de fête, mais destinés à entrer dans la sphère sociale effective du travail. Ce sont des tentes de marché, des protections pour un commerce léger et nomade. Ici rien qui pèse ou qui pose, mais une manière de faire dévier hors de la galerie et du circuit de l’art compris comme objet de distinction sociale le versant marchand de l’art lui-même. Les tentes ont un design vibrant du plaisir de suggérer, par les couleurs vives, actives, par des contrastes dynamiques, que des interventions artistiques légères donneront le désir de se réapproprier la vie. Une vie d’utopies réalistes…
Sylvie Coellier
Marseille, mai 2010
[ii] Cité par Boris Groÿs, Staline œuvre d’art totale, Nîmes, Jacqueline Chambon, p. 24.
[iii] 2003, œuvre reprise en 2008 au Parvis de Tarbes.
[iv] au Centre d’Art 3bis F à Aix
[v] Rizzo au Centre d’art contemporain de Istres (2005)
Texte de Lili Reynaud-Dewar, in Monographie – Véronique Rizzo, édition 02, Paris, 2006
ENGLISH TRANSLATION, CLICK HERE
« J’ai déjà dit qu’il était raisonnable de parler de la primitivité d’une situation en tant qu’opposition à ce qui est là. Cette primitivité est ce qui s’appelle le domaine de l’âme plutôt que celui de l’esprit. »
Richard Wright, Hello B No Clothes I Love You, 1996.
« Le genou dit à la géométrie : – Se mettre à genou, c’est la découverte de l’angle droit. La tête en train de réfléchir : – La géométrie naît du réflexe du corps qui se projette dans mon esprit. »
Lygia Clark, Lettre à Hélio Oiticica, Paris, 6 juillet 1974
On pourrait réduire et organiser les utopies esthétiques du siècle dernier en deux grands pans d’avant-gardes successives : l’utopie moderniste, l’utopie psychédélique. Elles partagent notamment l’objectif de réformer l’espace social et individuel par l’art et de proposer une conception radicalement nouvelle du monde, débarrassée de ses scories figuratives et de ses à priori représentationnels : l’abstraction comme le vecteur d’une harmonie nouvellement possible entre l’homme et le monde.
« Pour la Nouvelle Plastique, la nature est cette grande manifestation au travers de laquelle notre moi le plus profond est révélé et assume son apparence concrète. (…) Plus nous percevons l’harmonie de manière pure, plus nous pourrons exprimer plastiquement de manière pure la relation de la couleur et du son. »
« Le psychédélisme équivaut à une conscience de l’esprit grand ouvert. Psychédélique signifie extatique, ce qui veut dire se tenir en dehors des repères normaux. Cela signifie sortir de votre esprit, de votre monde habituel de contingences, espace et temps coordonnés. Et le point primordial : tout ce qui existe en dehors existe ici à l’intérieur. »
Equivalence globale du projet : retrouver une conscience ‘pure’ du monde, développer les moyens concrets de l’exprimer.
« La recherche de l’expression de la vastitude a entraîné la recherche de la plus grande tension possible : la ligne droite ; parce que toutes les lignes courbes se résolvent dans une droite, il ne reste plus de place à la courbe. »
« L’art psychédélique est généralement cinétique, vibrant, et animé par un mouvement d’incessante ébullition. »
L’importance des drogues dans l’expérience psychédélique n’explique qu’en partie la rupture caractéristique avec l’esthétique construite du modernisme. C’est également à un certain héritage moderne que s’attaquèrent les beatniks puis les hippies. Porteurs d’une utopie collective rejetant en bloc l’individualisme de la société bureaucratico-familiale des années 50/60 (de la même manière que le modernisme proposait un modèle collectif nouveau, en rupture avec le conservatisme de la société libérale bourgeoise du début du XXème siècle), ce qu’ils ont dénigré le plus frontalement était le rationalisme intégré et oppressant, hérité entre autres d’une certaine conception/déviance du modernisme. Enfin, pris dans son ensemble, du moins à partir des années 60, le mouvement psychédélique est anti-élitiste, de masse, et intègre à son projet esthétique tout un tas de motifs issus de la culture populaire, de la rue, de la musique pop, du folklore fashion, des croyances philosophico mystiques, des drogues hallucinogènes, de références à une culture visuelle éclatée (des tendances ornementales de l’Art Nouveau aux imprimés sériels orientaux), etc… Un double mouvement de dilution dans le mainstream et de diffusion vers le mainstream qui pose les conditions de la post-modernité et d’une autonomie réévaluée de la création. Face à la pureté – du moins revendiquée- du projet moderniste, le mouvement psychédélique est une idéologie esthétique et critique corrompue par son rapport massivement libéré à la culture populaire ; c’est un bâtard…
Alors qu’émerge aux Etats-Unis la pensée psychédélique, une scission s’opère au sein des artistes concrets, en Argentine et au Brésil, sous l’influence d’Hélio Oiticica et de Lygia Clark, et plus tard en France, au travers des expérimentations plastico-sociales du Groupe de Recherches d’Art Visuel.
A Sao Paulo et à Rio, l’esthétique rationaliste de l’art concret regroupe deux tendances : la tendance ‘paulista’, plus intellectuelle, et la tendance ‘carioca’, plus intuitive, à laquelle appartient Lygia Clark. « Moi, si je travaille, Mondrian, c’est pour me réaliser, au plus haut sens esthétique et religieux. Ce n’est pas pour faire des surfaces. Si j’expose, c’est pour transmettre à d’autres ce moment d’arrêt dans la dynamique cosmologique que l’artiste peut capter ». Sans rejeter en bloc la pensée de Mondrian, Lygia Clark et quelques ‘néo-concrets’ souhaitent lui donner une épaisseur cosmique qu’on pourrait considérer aux antipodes du projet rationnel de De Stijl (n’étaient ce les ambiguïtés associées à la quête d’absolue vérité du gourou du néo-plasticisme). Pour Lygia Clark, l’abstraction ouvre deux voies : « Lorsque l’artiste a aboli la figure et qu’il est entré dans l’abstraction, il y eut comme toujours, deux positions, l’une romantique, l’autre construite. Deux tendances différentes mais valables, car nécessaires à l’expression. » C’est l’alternative romantique que semble privilégier alors Lygia Clark, qui définit son rapport au monde comme « panthéiste ». Alternative qui fait écho à la bourgeonnante conception psychédélique de la création : traversée par le désir d’immersion dans le sublime et de communication avec l’univers, par le mythe d’une origine perdue et de la rupture (sociale, intellectuelle) indispensable pour fusionner à nouveau avec elle.
Dans cette quête de l’expérience absolue, il faut voir le préliminaire à une réévaluation du réel, à une volonté de transformation effective des rapports sociaux. Il n’y a pas contre-culture qui ne veuille agir « en tant qu’opposition à ce qui est là ».
Lygia Clark fera évoluer son art vers une renonciation de sa condition d’auteur, pour proposer uniquement « des situations dans lesquelles l’autre traverse des expériences, peut-être même pas esthétiques, mais plutôt sensorielles et psychologiques. »
Paris post 68, le GRAV pose les principes d’une abstraction perceptuelle et de l’effectivité de nouveaux modèles relationnels entre oeuvre et spectateurs. « En même temps que l’art à évolué du figuratif vers le réel, de la fiction vers l’événement, il s’est dépouillé de son lourd fardeau métaphysique. A partir de maintenant, il fait partie de la vraie vie (…) Il est, par-dessus tout, un facteur d’activation de nos sens. Je fais un art de sensations primaires. » Exit la dimension métaphysico cosmique de l’art, le sublime : le GRAV s’appuie uniquement sur les effets transmissibles au nerf optique par les moyens cinétiques. Des effets psychotropes sans la consommation de psychotropes… Peut-être est-ce de là qu’il faudrait partir pour tirer les conclusions de la brièveté du moment du GRAV. « L’Op Art, plus que n’importe quel autre mouvement artistique, semble finalement avoir obéi à la lettre à son principe d’obsolescence planifiée. » Sans doute faudrait-il aussi prendre en compte son intégration ultime à l’intérieur même des structures de l’establishment libéral et de la planification sociale, manière d’accomplir intégralement (d’achever) le projet de fusion (!) avec la réalité (quoique sans l’ampleur requise pour la pérennisation de l’alliance). Ailleurs, dans les années 70, Lygia Clark propose des situations et des objets transactionnels thérapeutiques…
En 2005, Véronique Rizzo s’approprie la juxtaposition et l’imbrication de plans colorés des Surfaces Modulées (1955) peintes par Clark durant sa période néo-concrète. Opérant une sorte de raccourci analytique du parcours de l’artiste, la reprise fonctionne littéralement comme mise à plat de la structure compositionnelle originale : un agencement de praticables, petits tapis de mousse recouverts de skaï ? de couleurs vives. Cette synthèse entre les débuts géométriques abstraits de Lygia Clark et ses années de recherche expérimentale autour du corps questionne bien sûr l’idée d’un usage à faire de l’abstraction, de son appropriation possible par le corps du spectateur. Mais c’est surtout le potentiel même de cet usage, à l’heure d’une normalisation relationnelle des oeuvres et d’une intégration normalisante des ‘motifs’ issus de l’abstraction par le design et la décoration intérieure, qui est l’objet d’une indécision revendiquée. Confortables et jolis, souples et pratiques, intégrés à l’espace (comme on pourrait le dire d’une cuisine en kit), les praticables de Véronique Rizzo demandent : Comment proposer maintenant une expérience relationnelle et corporelle radicale ? L’abstraction est-elle vraiment diluée dans un paysage adéquatement designé pour la souplesse de nos mouvements consuméristes ?
Posant ces questions devenues académiques, qui animent, de manière plus ou moins cynique ou nostalgique, le discours artistique actuel autour de l’héritage des avant-gardes, du modernisme et de l’abstraction, Véronique Rizzo y apporte un corpus de réponses et de stratégies marginales.
Clairement, si l’on devait reprendre la distinction opérée par Lygia Clark, les oeuvres de Véronique Rizzo se situeraient du côté d’une approche romantique de l’abstraction géométrique.
Mais cette approche romantico-intuitive, qui pourrait se réduire à un voeu pieu légèrement déphasé, voire dépassé, est contrebalancée et optimisée par un traitement ajusté de la culture populaire contemporaine. Les vidéos de Véronique Rizzo flirtent avec le V-Jaying et l’imagerie Acid House tout autant qu’avec les dispositifs optiques du GRAV et le Joshua White Light Show qui servit de fond multi-coloré aux groupes des années 60 . Elle utilise les logiciels 3D et de création d’images numériques à la manière d’une palette basique et ‘inspirante’, exploitant précisément leurs effets les plus connus et élémentaires, leurs tropes. Elle emprunte les titres de ses oeuvres à ceux d’albums de Soft Machine, à des mantras, ou encore à des injonctions de la contre-culture numérique, télescopage post-moderne qui signe l’inscription de son travail dans une culture contemporaine qu’on a appelée celle du pixel.
Plus qu’à l’utopie moderniste et à l’abstraction ‘construite’, c’est à l’utopie psychédélique et à l’abstraction perceptuelle que s’arriment ses oeuvres. Vibrantes, flashy, englobantes, les vidéos et les peintures murales de Véronique Rizzo développent une esthétique pléthorique de l’appeal visuel et de l’effet. C’est d’une dynamique exponentielle dont il s’agit chez elle, une méthode de pandore, qui produit non seulement l’effet perceptif du mouvement permanent, mais aussi l’effet dialectique du mouvement permanent. Aucune image ne prévaut sur une autre, aucun motif ne prévaut un autre, aucune priorité n’est organisée, pas de tri sélectif, pas de désignation référentielle, pas de hiérarchie. Ce faisant, elle affirme deux orientations à la fois contradictoires et combinatoires : celle, critique, d’une appréhension atmosphérique de l’abstraction, même plus décorative ni ornementale, seulement ambiante, et celle, idéaliste, d’une appréhension intuitive de l’abstraction, délestée de sa rigidité analytique, réinvestie d’un pouvoir de négociation avec la dimension physique du spectateur. Plus symboliquement, il s’agit à travers cette dé-hiérarchisation, de poser les bases d’une possible libération sensorielle, à la manière psychédélique, de reconduire un certain nombre de stratégies de désorientation induites, soit par la consommation de drogues, soit par le travail cinétique sur le nerf optique.
Or, l’articulation de ces deux appréhensions formule bien un constat paranoïaque à l’égard de la récupération des formes issues de l’abstraction par l’imagerie libérale, constat suivi de ses tentatives, non de réhabilitation de ces formes corrompues par la société post-industrielle, mais de leur ré-exploitation, au sens à la fois spatial et économique. Car si l’on sait bien aujourd’hui que les oeuvres les plus immatérielles n’échappent pas plus à leur merchandization que les ‘objets d’art’, il n’en demeure pas moins que l’espace intime et sensoriel demeure le lieu privilégié pour la construction d’un monde en retrait de l’oppression économique et des idéologies dominantes.
En 1992, en pleine période Baggy , le groupe écossais Primal Scream formule ce voeu, comme une injonction entendue en rêve, pour introduire son tube, Loaded : « What is it exactly that you want to do ? We want to be free. And we want to get loaded. And we want to have a good time. » Slogan psychédélique type, quoique pragmatiquement amputé de toute ambition révolutionnaire. Concocté par un groupe d’obédience orthodoxe indie pop, Loaded fusionne adéquatement la pop et les influences de la déferlante House sur la Grande-Bretagne de la fin des années 80, qu’on appela le Second Summer of Love. Le Second Summer of Love réitère les motifs du ‘moment psychédélique’ : la drogue, la musique, et leur expérience collective sur fond de contre-culture organisée (avec entre autres son célèbre son club, l’Hacienda de Manchester) : l’hédonisme comme arme contestataire.
Tout comme le mouvement hippie, le Second Summer Of Love fut stigmatisé comme un mouvement de repli communautaire des jeunes autour de valeurs moins constructives et réformatrices que destinées à occulter la réalité et s’en échapper… Vision évidemment conservatrice, destinée à dénigrer l’importance d’une contestation en marge des structures politiques organisées. Mais la différence fondamentale avec le mouvement hippie, c’est qu’alors que celui-ci en appelait à un retour à une sorte de lifestyle originel, à la ‘primitivité’ d’un paradis perdu relevant d’un mythe (particulièrement américain, rien d’étonnant donc à ce le mouvement hippie soit né sur le continent américain), le Second Summer Of Love, empruntant son nom au Summer of Love de 1967 à San Francisco, se rattachait idéologiquement à une ère idéale vieille peine trente ans… Un hédonisme post-moderne ?
C’est le cas du discours hédoniste à l’oeuvre chez Véronique Rizzo, entre le traitement d’une imagerie historique et l’immersion du spectateur dans des sphères parallèles d’un indéniable présent sensoriel.
1. Texte de l’artiste, décrivant de manière subjective les effets du LSD, dans My Head Is On Fire But My Heart Is Full Of Love, cat de l’exposition éponyme au Charlottenburg Exhibition Hall, Copenhague, ed. Modern Institute, 2002, p. 48, publié la première fois par Transmission Gallery, Glasgow, 1996. (ma traduction)
2. Lygia Clark-Hélio Oiticica : Cartas, 1964-1974, Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 1996, reproduit dans cat. Lygia Clark RMN 1998, p.288.
3. Piet Mondrian, Dialogue on the New Plastic, publié dans deux numéros de la revue De Stijl, février et mars 1919, republié dans Art In Theory 1900-2000, Charles Harrisson & Paul Wood, 2nd edition, 2002, p. 286. (ma traduction)
4. Michael Hollingshead, The Man Who Turned On The World, London, Blond & Briggs, 1973. Cité par Andrew Wilson, dans Spontaneous Underground, An Introduction to London Psychedelic Scenes, 1965-1968, in Summer of Love, Psychedelic Art, Social Crisis and Counterculture in the 1960s, ed. Christoph Grunenberg and Jonathan Harris, Liverpool University Press and Tate Liverpool, 2005, p. 63. (ma traduction)
5. Piet Mondrian, op. cit. p. 78.
6. Barry N. Schwartz, Psychedelic Art, 1968, cité Matthieu Poirier dans Hyper-Optical and Kinetic Stimulation, Happenings and Films in France, in Summer of Love, op.cit. p. 282. (ma traduction)
7. Lygia Clark, Lettre à Mondrian, Mai 1959, reproduit dans cat. Lygia Clark, op.cit., p.114.
8. Lygia Clark, 1960, reproduit dans cat. Lygia Clark, op.cit., p.139.
9. « La nature m’a nourrie et équilibrée quasiment de manière panthéiste », Lettre à Mondrian, op. cit.
10. Richard Wright, op.cit.
11. Ferreira Gullar, La trajectoire de Lygia Clark, cat. Lygia Clark, op. cit., p. 67.
12. Carlos Cruz-Diez, cité par Matthieu Poirier, dans Summer Of Love, op. cit. p. 284. (ma traduction)
13. Vincent Pécoil, Op Stars, Art Monthly n° 270, october 2003, p. 9. (ma traduction)
14. A ce sujet, lire l’entretien entre Edwin Pouncey et Joshua White, in Summer of Love, op. cit. p. 164-178.
15. Baggy, adj : ample, large. La musique des Happy Mondays, des Stone Roses, etc, et occasionnellement de Primal Scream… est appelée ainsi à cause des larges et mous portés par ces groupes, inspirés par la mode des dance floor house.
16. « Qu’est ce vous faire au juste ? Nous voulons être libre. Et nous voulons nous défoncer. Et nous voulons prendre du bon temps. » Album Screamadelica, Creation Records, 1992
Texte de Guillaume Mansart – 2008
Le travail de Véronique Rizzo s’appuie sur une connaissance approfondies des grands moments de histoire de l’art récente. Principalement tournée vers l’abstraction (des avant-gardes russes jusqu’à l’op art en passant par l’art concret ou le Bauhaus…) cette compréhension précise pose les bases d’une pratique qui redéfinie, se détache, contredit ou amplifie ces fondements théoriques.
Véronique Rizzo opère à l’aune des transformations du monde et des remises en cause, de l’échec ou des réussites des programmes idéologiques qui ont accompagnés les abstractions modernistes. Portant un regard tour à tour ironique ou partisan sur cette pensée formelle, elle puise son vocabulaire plastique dans ces géométries chargées de sens. Que ce soit les motifs de Vasarely dans sa vidéo Tilos, ceux de Jean Arp ou Pol Bury dans Gestalt, ils constituent le socle d’un art qui, à l’heure des techniques numériques, rejoue ces expérimentations visuelles, les animent et les mixent…
Car à l’image arrêtée de la peinture succède le mouvement de la vidéo, car à l’enfermement de la forme pure et autonome se substitue l’inclusion de motifs issus de la culture populaire. Génériques d’émissions de télévision ou de films des années 1960-70, BD, science-fiction, cultures urbaines, musiques électroniques, psychédélisme… Tout se rencontre et coïncide d’une manière ou d’une autre dans cette oeuvre de synthèse.
Et puisque les utopies sont tombées sous le feux de politiques trop rationnelles, puisque les formes cinétiques se sont fait rattraper par l’industrie de la communication de masse, de l’identité visuelle, de la permanence de l’image, alors Véronique Rizzo prend acte et joue le jeu du sensoriel et du sensationnel.
Les (installations) vidéos qu’elle réalise ont une charge vibratoire qui les placent invariablement du côté de l’expérience corporelle. Parfois oppressante (Panopticon XXX), résonnante (Tilos), narrative (Labyrinthe vert), ou hypnotique (Sun1), elles disent intensément la puissance émotionnelle de la forme. Si le travail de Véronique Rizzo peut être perçu comme une mise en question, il doit également être compris comme une affirmation, celle qui dit la validité du motif sur une réalité physique. C’est cette force opérante qui se donne à lire sans détour dans cette géométrie vivante et sensible.
SPLIT SCREEN
Interview entre Pedro Morais et Véronique Rizzo, in calalog SPLIT SCREEN, Zéro2 éditions, 2006
ENGLISH TRANSLATION, CLICK HERE
Dans ton travail, il y a des références évidentes à l’histoire de l’abstraction moderne. Comment te situerais-tu par rapport au modernisme dans un contexte artistique qui arrive après sa remise en question ?
L’abstraction moderne correspond à une succession de réflexions formelles liées à des projets de société utopiques. J’arrive après cette période de certitudes, quand il n’y a plus de discours référents. Aujourd’hui, on peut avoir une interprétation rétrospective des différentes solutions globales par le biais d’une distance. Il s’agit d’une situation hors d’un grand récit, mais où les expérimentations modernes nous permettent d’opérer des possibles à l’échelle de visions plus singulières. Le modernisme avait développé une machine critique à la fois sur les formes de l’art et sur les projets économiques et politiques; nous nous retrouvons face à un répertoire des programmes, de leurs échecs et de leurs réussites. Envisager une méta-critique du modernisme ne signifie pas, cependant, délaisser son héritage. L’histoire est toujours en marche dans un enchaînement d’effets et de causes. C’est la fois fascinant et totalement vain.
Plutôt que de manipuler les formes abstraites comme un répertoire que l’on mixe, tu sembles interpréter le fait qu’elles soient issues de projets idéologiques.
L’histoire moderne pose la question philosophique du progrès et il me semblait intéressant de la reprendre. J’y fais allusion, de manière parodique, dans la vidéo Gestalt, en faisant cohabiter des figures dont les formes renvoient aux différents passages de l’abstraction du XX siècle : du Bauhaus, à Arp, en passant par Pol Bury et aux formes plus sophistiquées des années 50 qui préfigurent l’emploi de l’électronique. Le titre, Gestalt, est emprunté à la série d’œuvres de Robert Morris qui marquent le lien entre le modernisme et le minimalisme, quand l’objet autonome devient « specific object », et, que l’art devient le miroir opaque d’une
« société universellement industrialisée », comme le soulève Hal Foster*. Dans la vidéo, les formes évoluent dans un espace à la fois cosmique et plat, circonscrit par l’écran. Je m’éloigne dans un long travelling arrière, en partant du fonctionnement interne d’une des formes, jusqu’à faire disparaître dans le temps cette ronde d’îlots hétérogènes. C’est une fable ironique sur des structures qui cherchent vainement à communiquer par des impulsions électriques. La musique instrumentale que j’utilise renvoie directement aux interludes des années 60, la préhistoire de la télévision, ces moments sans événement, placés entre deux émissions, où l’on pouvait dormir, penser à plein de choses et à rien.
Dans la série Homogéneité, Fragmentation, Hiérarchisation, tu associes Vasarely à la critique du capitalisme de Henri Lefebvre, évoquée par le titre. Il s’agit moins d’une simple revisitation de l’abstraction géométrique que d’y introduire une perturbation.
Dans Tilos (de la série Homogénéité, Fragmentation, Hiérarchisation), j’utilise un motif de Vasarely pour lui faire subir une accumulation exponentielle, perturbée par le mouvement d’une sphère. Je prolonge jusqu’à la saturation son idée de la transformation d’un champ répétitif à travers l’incursion du volume par le mouvement. L’art cinétique est ici déstabilisé par l’utilisation des technologies numériques. Tilos réactive le motif du carré arrondi, que j’associe au moment charnière des années 60 où la société industrielle arrive au stade de la consommation triomphante. Le carré représente la logique, l’organisation, le programme, tandis que l’arrondi signifie le mode insidieux qu’a la consommation de façonner notre environnement. Homogénéité, Fragmentation, Hiérarchisation est la formule que Lefebvre développe dans La Production de l’Espace*, où il analyse comment le mode de production capitaliste organise, les rapports sociaux, mais aussi l’espace et le temps. Vasarely, tout en ayant un projet utopique de société égalitaire, a fini par intégrer ce système. La confrontation des deux met en avant les contradictions du projet moderne. Le spectateur dans l’installation éprouve l’effet d’un espace clos, entièrement balisé et normatif, la synthèse d’un espace kafkaïen.
Dans le prolongement de cette réflexion sur l’organisation de l’espace, l’installation Panopticon donne à voir la déambulation d’une sphère à l’intérieur d’une super-structure, jusqu’à que l’on s’aperçoive que cette machine se reproduit en boucle. Qui dirige ce labyrinthe où la sphère déambule? Elle tombe dans une succession d’abîmes qui rétrécissent l’espace, jusqu’à la prise de conscience de l’ensemble du système auquel elle participe. D’une autre manière, Ligne de Fuite se présente comme une grille horizontale, un mur, qui donne l’impression d’avancer vers celui qui le regarde. Les lignes se déforment autour d’un point focal pour donner lieu un autre espace. C’est un film d’anticipation qui n’apporte pas de réponses. Est-ce que l’espace arrive sur nous et nous écrase ou est-ce que l’on peut traverser les lignes et aller vers des projections possibles ?
Contrairement à l’abstraction moderne, tu rends problématique la prétention des formes à l’autonomie, à travers une lecture consciente de leurs usages culturels.Il est impossible de te classer dans un contexte formaliste ou, à l’inverse, dans la citation ironique.
Au début de mon travail, il était impossible de m’inscrire dans la continuité de l’abstraction géométrique. J’arrivais après. Ce que j’y trouvais alors me semblaient être des pratiques laborieuses de déclinaison de motifs, des contraintes sans enjeu spécifique. Quand je cherche à me donner des contraintes, je les circonscris à une série et non pas à l’ensemble de ma démarche. Il s’agit de mettre en confrontation des éléments formels, de leur faire cracher leur puissance. Je trouve dans les discours issus du modernisme des paradigmes que j’interroge dans ce qu’ils incarnent maintenant. Quand je porte un regard sur une période, je la prends globalement, en relation avec les arts appliqués ou la culture populaire. Dans Labyrinth Vert, le carré arrondi devient un dédale, un casse-tête chinois. La boule fait exploser le cadre contraignant de la surface pour faire intervenir l’idée d’espace, introduit le désordre où elle trouve finalement la libération. Je pensais à ces objets ludiques qui ont accompagné l’avènement de la consommation de masse des années 60, les flippers de poche ou le rubik cube, une magie de plastique.
Plus qu’à des mouvements historiques, je m’intéresse à certains artistes. Blinky Palermo me touche beaucoup dans son approche de l’abstraction, à l’écart des doctrines, faisant corps avec l’espace dans une réduction à des formes à la fois neutres et sensibles. Il y a aussi dans son travail l’idée du programme, d’une clé qui régit l’œuvre, comme dans « To the people from NYC ».
Si ta démarche semble passer par la logique, la géométrie, elle intègre aussi une approche sensorielle qui essaie de produire des effets dynamiques chez le spectateur, ne cherchant pas à dissocier la rationalité de la sensorialité.
C’est ce que l’on retrouve dans le film Pataphysical Introduction, où la forme elliptique apparaît sur une surface plate et devient hallucinée. J’ai cherché à habiter l’intérieur de l’ovale en passant de la surface à la matière, un ersatz de 3D. Au même moment, j’écoutais Soft Machine, à qui j’ai emprunté littéralement le titre pour développer une narration, une sorte de récit atmosphérique que je peut résumer par « naissance, vie et mort d’une patate électrique », déplaçant à mon compte l’humour pataphysicien. À la fin de la vidéo, la forme prend feu, c’est à la fois inattendu et dans le cliché, un paradoxe qui m’intéresse. La musique expérimentale des années 70, certains psychédélismes, avaient une relation avec la pataphysique et leur réflexion absurde sur l’existence. C’est une époque qui a réessayé d’inventer des mythes et des cosmogonies, une sorte de « régression » par rapport aux grandes idéologies. La musique de Sun Ra, qui accompagne la vidéo, résonne avec les couleurs, le marron et le bleu ciel que j’associe à cette époque. Ellsworth Kelly parlait de l’intelligence des ensembles de couleurs, des bonds que fait la perception quand on les juxtapose de façon dissonante. Il y a un langage des couleurs, expérimenté par l’abstraction, dont on a maintenant une mémoire.
Le passage de la peinture à la vidéo semble correspondre chez toi à une certaine approche de la narration, où tu ne retiendrais que l’architecture des récits.
La vidéo me donnait la possibilité d’imaginer des peintures en mouvement au lieu d’ancrer la composition dans un temps stable. Je construis la narration en faisant réagir les termes formels par une interaction avec le contexte. Comme une équation mathématique, qui recevrait nos projections mentales et évoluerait dans l’espace-temps, une géométrie avec des résonances sensibles. Dans la plupart des vidéos, ce sont les sphères qui déclenchent des dynamiques ou des récits. Sphères de réalités possibles, donne à voir l’errance de ces formes qui ressemblent à des planètes, des entités sensibles avec une singularité donnée par les motifs qu’elles portent en mise en abîme. La gestuelle des sphères sur le fond sans architecture, les mouvements de la caméra virtuelle induisent un récit chorégraphié, entre le jeu vidéo et le clip, une sorte de « space opéra bollywoodien ». Il y a des aventures, des histoires d’amour et un épilogue accompagné d’une musique de Lalo Schiffrin qui mêle le fonctionnement narratif de la série télé à l’hédonisme de ces motifs abstraits.
L’utilisation de la musique a une place déterminante : tu sembles faire usage de thèmes instrumentaux, abstraits pourrait-on dire, dans sa capacité à faire fonctionner des projections mentales qui deviennent narratives.
Dans Bouches, j’utilise la musique de John Barry pour sa capacité à nous introduire immédiatement dans un univers dramatique. C’est le compositeur du thème de James Bond dont les génériques étaient magnifiques, à la pointe du design graphique. Ils synthétisaient l’esprit d’une séduction. Cela rejoint ma réflexion sur les possibilités d’un motif abstrait à poser une dramaturgie. Pour cette vidéo, je pars d’une forme trouvée dans l’espace public que je décline, faisant en sorte qu’elle nous attire et nous repousse. D’un maelström liquide, elle devient fractale, pour ensuite durcir et saturer tout l’espace. C’est un voyage intérieur que je rapproche de la névrose, un motif obsessionnel qui rempli la vision, prenant toutes les formes possibles tout en restant la même chose. Cependant, la musique n’est pas toujours utilisée comme une trame narrative. La collaboration que je développe avec des musiciens électro-acoustiques conduit à trouver des transpositions entre les formes et les sons pour construire des environnements immersifs.
Contrairement au cinéma, qui ouvre une fenêtre sur des espaces narratifs et nous fait oublier le contexte, notre corps même, tu crées des environnements qui nous ramènent constamment à la surface, impliquant notre sensorialité dans un rapport au lieu de l’exposition. En cela, ton travail se situerait dans un dialogue, adultère peut-être, avec le cinéma expérimental de Len Lye ou Paul Sharits.
Il est difficile d’établir un rapport direct avec le cinéma des avant-gardes historiques quand on est entourés d’écrans de veille d’ordinateur et d’une pléthore de pratiques de veejaying. Mais je me sens proche de la position de ces cinéastes, de leur volonté d’ancrer les formes dans un rituel « synesthésique ». J’essaie de développer cela à travers l’installation, en passant de la surface à l’espace in situ, puis de l’image vidéo à la construction d’objets, de prototypes, d’architectures.
De cette tradition expérimentale, je retiens l’attitude générale qui s’est tenu dans les marges pour créer du choc en mixant les champs spécifiques, et perturber le point de vue classique. Faire coexister les représentations c’est donner une intuition de la relativité; contaminer le réel par des images subliminales, c’est identifier les mécanismes de pouvoirs sur les outils de communication visuelle. Dans mes dispositifs, on se retrouve à l’intérieur de projections d’espaces mentaux qui perturbent la conscience d’une réalité stable. Le rythme, la vitesse, les mouvements des formes et des couleurs influent peut-être sur des zones encore méconnues du cerveau. Je crois en une résonance des percepts aux formes, et je veux expérimenter le motif pour son potentiel narratif et sa puissance d’implication émotionnelle dans l’espace. La confrontation à une présence forte de l’altérité abstraite révèle la coïncidence du corporel et du conceptuel, une extériorité spectaculaire qui nous renvoie comme dans un miroir, au lieu d’une inextricable intériorité.
1 Hal Foster, p 94 in « l’enjeu du minimalisme », Le retour du réel , 1996 – editions La lettre volée
2 Henri Lefevbre, préface, p 23, La production de l’espace, 1974 – editions Anthropos
Texte de Jean-Louis Delbès, 2000
L’évolution de l’art de Véronique Rizzo suit une voie originale.
A l’égale d’artistes russes comme Rosanova, Popova ou Exter, elle développe un raisonnement autonome, surprenant par son amplitude chromatique et mentale, elle distribue ses formes telles des forces « aspiratrices » sur une surface délétère et poudrée. Rizzo fonde sa pensée sur les contraintes de la planéité. C’est la mise en place d’un chaos réglé et contaminateur, à la recherche de toile en toile d’un ordre qui soit aussi un désordre. Rizzo nous dépose à l’extérieur du tableau, là où l’immatériel prolifère.
(English Translation) The evolution of Veronique Rizzo’s art follows an original path. Like Russian artists such as Rosanova, Popova or Exter, she develops an autonomous reason, surprising in its chromatic and mental amplitude, she distributes her forms like « aspirating » forces on a deleterious and powdery surface. Rizzo bases her thought on the constraints of flatness. It’s about putting into place an ordered and contaminating chaos, searching from canvas to canvas for an order which is also disorder. Rizzo leaves us outside the painting, where the immaterial prospers.
Texte de Véronique Rizzo, 2000
Ma position stylistique est un « mix » de la peinture historique, abstraite-géométrique et d’une culture populaire et urbaine. J’essaie de trouver un lieu synthétique par lequel ces traditions se rejoignent et forment une nouvelle identité. Je travaille sur la fascination, la charge émotionnelle liée aux images, leur puissance de projection et d’introjection, leur capacité d’être un miroir de la conscience. Je les utilise comme un langage, un appareil sémantique, une nouvelle syntaxe. Les série sont des tentatives diverses de propos, éthiques, métaphysiques, politiques, existentiels. D’autres images sont plus formelles, plus abstraites, concentrées sur la recherche de l’effet conjugué des formes géométriques et d’un chromatisme bizarre, à représenter et à faire vivre, une sensation physique et dynamique de l’espace.
Mon travail s’oriente donc de plus en plus vers une recherche plastique de la représentation d’espaces ambigus et hallucinatoires qui agissent comme révélateurs d’une relation psycho-sensorielle de la conscience à la spatialité, à l’image comme espace environnemental.
(English Translation) In my case, pictorial activity is first linked to the conception of images.
My stylistic position is a « mix » of historical painting, abstract-geometric, and popular and urban culture. I try to find a synthetic link by which these traditions can merge and form a new identity. I work on fascination, the emotional charge linked to images, their power of projection and introjection, their capacity to mirror conscience. I use them as a language, a semantic tool, a new syntax. The series are various attempts at ethical, metaphysical, political, and existential propositions. Other images are more formal, more abstract, concentrated on the research of the effect combined with geometric forms and weird chromatics, to represent and to allow one to live a physical and dynamic sensation of space. My work thus orients itself increasingly towards an artistic search for the representation of hallucinatory and ambiguous spaces acting to reveal a psycho-sensorial relation of conscience to spatiality, to the image as environmental space.